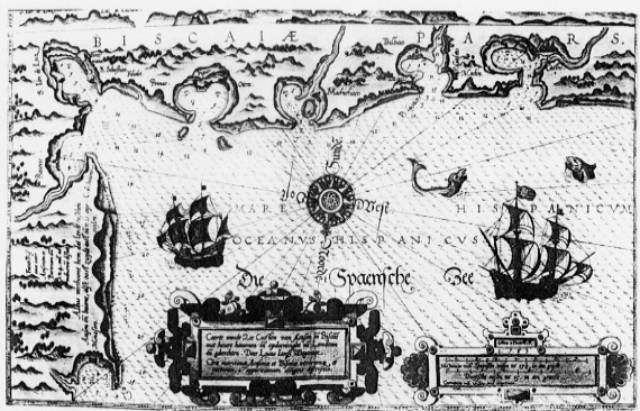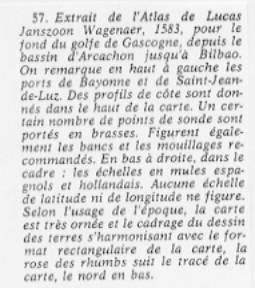16/09/98 - RECHERCHE DOCUMENTAIRE : ZONE HENDAYE - CAPBRETON
(suite)
PREAMBULE
Lors du circuit exploratoire effectué cet été, je me demandais comment agrémenter le trajet entre les étapes, et comment enrichir les haltes à chaque étape, notamment celles qui n'avaient qu'un cadran solaire.
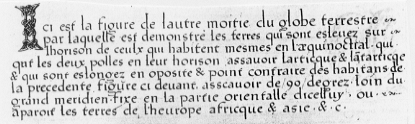 C'est
la raison pour laquelle j'ai commencé à me documenter d'abord
sur le plan historique, avec la revue "Connaître le Pays Basque"
et le livre "Histoire de Capbreton".
C'est
la raison pour laquelle j'ai commencé à me documenter d'abord
sur le plan historique, avec la revue "Connaître le Pays Basque"
et le livre "Histoire de Capbreton". 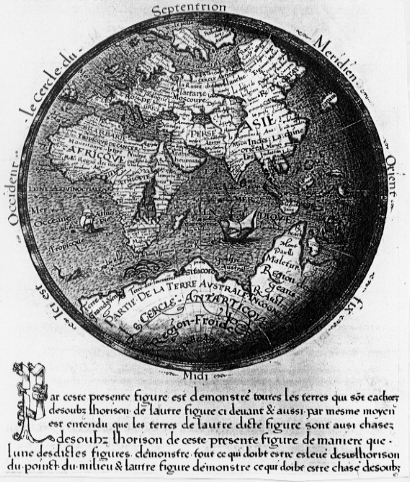 J'ai
alors pris conscience que la mer, la pêche et la marine de guerre, avaient
une importance très considérable dans le passé, autant
pour les Basques que les Landais, et que le passage de la pêche côtière
à la pêche hauturière montrait un dynamisme qui valait
le coup d'être étudié. En outre, cela m'a fait découvrir
un lien que je ne faisais que soupçonner entre la marine et l'astronomie,
sujet principal de ce rallye.
J'ai
alors pris conscience que la mer, la pêche et la marine de guerre, avaient
une importance très considérable dans le passé, autant
pour les Basques que les Landais, et que le passage de la pêche côtière
à la pêche hauturière montrait un dynamisme qui valait
le coup d'être étudié. En outre, cela m'a fait découvrir
un lien que je ne faisais que soupçonner entre la marine et l'astronomie,
sujet principal de ce rallye.
BIBLIOGRAPHIE : L'instrument de marine (Jean Randier - Celiv)- La boussole (Brigitte Coppin - Casterman) - ABC de l'astronomie (Maurice Oliveau - Arthaud) - Ici et là : Le Pays Basque - Ciel et espace: L'observatoire des marées terrestres (janvier 1998)
Notes de lecture sur "L'instrument de marine"
INTRODUCTION - LA NAVIGATION A L'ESTIME
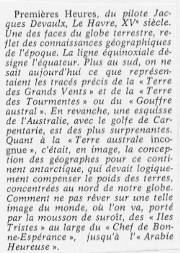 Avant
le XVème siècle, il y a peu d'information sur les techniques
d'aide à la navigation.
Avant
le XVème siècle, il y a peu d'information sur les techniques
d'aide à la navigation.
Dans les récits de voyages de Saint Paul ou de Marco Polo, il est mentionné
l'usage du plomb de sonde et d'une boussole élémentaire.
Au Moyen Age, en Méditerranée, les marins vont sans carte, sans
instrument de hauteur (astrolabe) et sans boussole. Ils se dirigent seulement
de cap en cap et mesurent la profondeur des fonds au fil à plomb.
1386 : Découverte des Canaries par Lanzarote Malocello : il a dû
utiliser des instruments de latitude et de direction pour revenir au Portugal,
transmis par les Vénitiens qui en avaient déjà créé
auparavant, de même que des cartes.
1394-1460 : Henri le Navigateur (un des fils de Jean 1er de Portugal), fondateur
de l'école de Sagres, qui forme nombre de grands pilotes (instruction
dont a bénéficié Vasco de Gama lors de son voyage en
1497 vers le Mozambique et les Indes : compte tenu de la durée de son
trajet, il a dû "couper" par 20° Ouest).
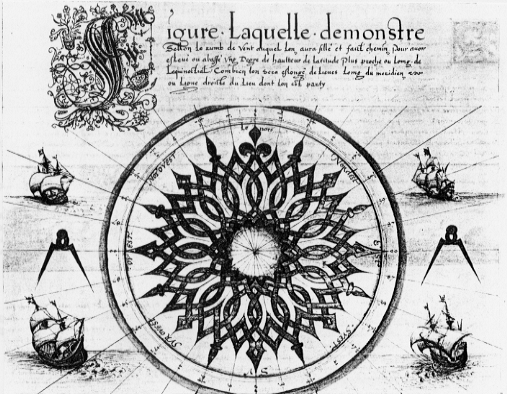 Les
pierres d'aimant sont faites de magnétite Fe3 O4 - Elles sont d'abord
utilisées dans les sciences occultes et ésotériques (Chine,
sagas Scandinaves) puis pour la navigation.
Les
pierres d'aimant sont faites de magnétite Fe3 O4 - Elles sont d'abord
utilisées dans les sciences occultes et ésotériques (Chine,
sagas Scandinaves) puis pour la navigation.
A partir du XVIIIème siècle, on utilise aussi des aciers aimantables
pour réaimanter les compas (boussoles) et "raviver"' les
aiguilles d'acier.
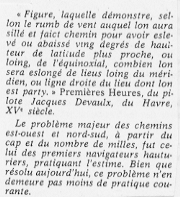 Dès
le XVème siècle, la navigation à l'estime ("dead
reckoning") devient une réalité : des "options"
sont prises sur la conception du monde. On effectue une représentation
plane du monde avec des coordonnées polaires, angle et distance, pour
la navigation - la boussole donne l'angle - le loch donne la vitesse, d'où
la distance en fonction des heures de route. La latitude et la longitude sont
encore inconnues et ne sont pas tracées sur les cartes. La latitude
est mesurable à midi en mesurant la hauteur du soleil à l'astrolabe
ou à l'arbalète.
Dès
le XVème siècle, la navigation à l'estime ("dead
reckoning") devient une réalité : des "options"
sont prises sur la conception du monde. On effectue une représentation
plane du monde avec des coordonnées polaires, angle et distance, pour
la navigation - la boussole donne l'angle - le loch donne la vitesse, d'où
la distance en fonction des heures de route. La latitude et la longitude sont
encore inconnues et ne sont pas tracées sur les cartes. La latitude
est mesurable à midi en mesurant la hauteur du soleil à l'astrolabe
ou à l'arbalète.
Par contre, il manque encore le canevas de Mercator et la notion de latitude
croissante pour situer le parallèle et il faudra attendre 3 siècles
l'invention du chronomètre de marine pour déterminer la longitude
avec précision.
Le cap vrai et la distance parcourue sont les premiers éléments
de la navigation maritime. Les premières cartes marines sont établies
"par routes et distances".
Elle a deux origines :
- Des Chinois, elle a été transmise aux Arabes, qui l'ont montrée
aux Vénitiens.
- Xlème siècle : apportée en Méditerranée
par les Normands (origine Scandinave).
Aimant : pierre aimée du fer.
Magnet, magnétite : de la Magnésie, région d'Ionie (Grèce)
où la pierre abondait.
Initialement, on remplissait un fétu (ou calamus) d'oxyde de fer, que
l'on mettait à flotter sur de l'eau.
Puis on utilisa une tige d'acier aimantée, montée sur pivot
(plus pratique en mer).
Au XVème siècle, on ajouta la rose.
Différentes sortes de cuvettes pouvaient la contenir : ronde, carrée,
unique, multiple, lestée de plomb, en cuivre chaudronné. ..
L'astronome Arago observe que les oscillations de l'aiguille s'amortissent plus vite au-dessus d'une plaque de cuivre et en conseille l'utilisation.
La déclinaison magnétique
XVème siècle : elle est très faible en Europe : il s'agit
de la différence d'orientation entre le nord vrai (étoile du
Nord) et le nord du compas.
Croyant que cette différence est due à la forme de l'aiguille,
on en fabrique de toutes sortes.
En fait, la déclinaison est variable selon les lieux, et aussi dans
le temps pour un lieu donné.
Au XIXème siècle, Coulomb prouve que le trou de la chape et
la forme des aiguilles importent peu, seule la masse d'acier compte.
1876 : Adoption de la rose Thomson pour compas sec.
1880 : Généralisation du compas liquide qui résout les
problèmes de frottement (retour aux origines) - On fait flotter sur
de l'alcool ou de la glycérine (liquide incongelable) une rose posée
sur un anneau circulaire qui sert de flotteur, qui comporte un important barreau
aimanté - Insensible aux mouvements du bateau.
1914-1918 : invention du compas gyroscopique.
Compas de relèvement ou d'azimut
II permet d'observer la position du soleil à midi ou de l'étoile
polaire, que l'on compare avec la direction nord-sud indiquée par le
compas : ce contrôle permet de mesurer la variation du compas (c'est
comme un cadran solaire superposé au compas pour contrôle).
XVIème siècle : en plus, il est ouvert 6 fenêtres dans
les 3 boîtes montées sur cardan pour viser un point à
terre (amer) et porter un relèvement, lieu géométrique.
C'est un instrument déplaçable sur le navire pour faciliter
la visée, mais très primitif (utilisé jusqu'au XIXème
siècle).
Mieux : modèle à alidade centrale à pinnules (issue de
l'astrolabe pour s'appliquer à une couronne horizontale).
Dès 1650, on observe des déviations du compas à bord,
dues aux masses ferreuses (du navire et des canons). La solution pour y pallier
est seulement trouvée au XIXème siècle.
1603 : "Mécométrie de l'aymant ou l'art de trouver la longitude
par la déclinaison" de Guillaume le Nautonnier.
1700 : Halley publie une carte avec un méridien de déclinaison
nulle et un changement de sens de la déclinaison (c'est nouveau) et
cartographie les isogones (lieux de même déclinaison) : cartes
de magnétisme.
XIXème siècle : Le compas magnétique atteint son plus
haut degré de perfectionnement (depuis la rose d'Amalfi jusqu'au compas
d'habitacle Thomson) - il est détrôné par l'invention
du compas gyroscopique.
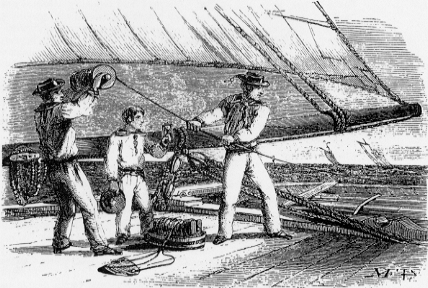 Mesurer
le chemin parcouru : du loch à bateau au sillomètre
Mesurer
le chemin parcouru : du loch à bateau au sillomètre
Le compas magnétique, c'est la conquête de la direction (premier élément de l'estime). La maîtrise de la vitesse (autre élément du point estimé) a pris autant de temps. Les meilleurs sillomètres ("mesure du sillage" = mesure de la vitesse) sont fabriqués au XIXème siècle, pour disparaître début XXème (comme le "magnétique" chassé par le "gyro") avec les tours d'hélice qui servent de compteur de milles.
Jusqu'à la fin XVIIIème, tous les voyages sont faits à l'estime, en particulier pour calculer la longitude. A partir de l'invention des distances lunaires (méthode sans chronomètre), c'est la bataille entre les partisans de la méthode astronomique et les marins routiniers.
Loch vient de log, ou bûche, morceau de bois jeté à l'avant du bateau et dont on mesurait le temps de passage jusqu'à l'arrière (la longueur du bateau étant connue, on estimait la vitesse par une règle de 3 et donc la distance parcourue depuis le point de départ) : méthode très approximative.
1577 : premier loch en progrès sur la bûche : plateau lesté
fixé à une corde à nœud enroulée sur un dévidoir.
On le jetait dans le sillage à l'arrière du bateau et la corde
se dévidait pendant le temps indiqué par un sablier (ampoulette)
(15 à 30 secondes), puis on arrêtait le déroulement et
en remontant la corde, on comptait les nœuds.
Problème de calcul du mille, donc de la valeur du nœud.
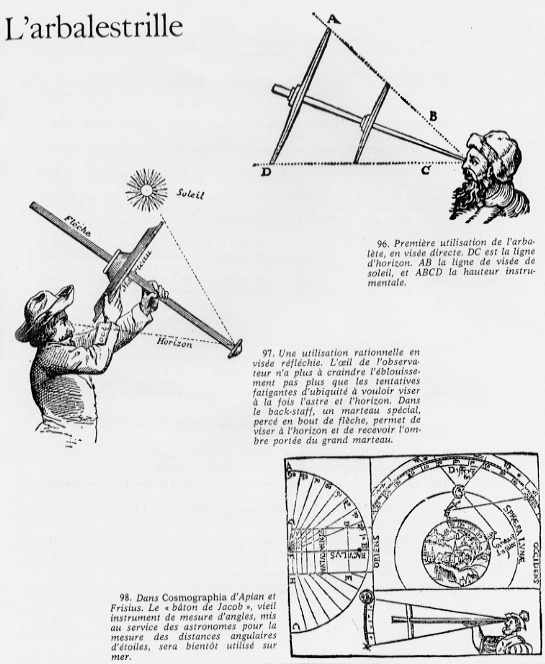 1589
: Richard Wright donne 5 580 km pour le rayon de la terre - erreur de 800
km
1589
: Richard Wright donne 5 580 km pour le rayon de la terre - erreur de 800
km
Norwood mesure pour le mille l 866,6 mètres, donc des nœuds théoriques
de 51 pieds et pratiques de 50 pieds : c'est beaucoup mieux que les 42 pieds
utilisés par les pilotes. Le problème des erreurs se pose surtout
pour les voyages en longitude (voyage de Colomb), tant qu'il n'y a pas de
moyen de contrôle comme la méridienne de soleil pour les chemins
le long des méridiens.
1693 et 1720 : la lieue marine de France et d'Angleterre s'impose : 3 milles
(une minute à l'équateur) -1 mille = 10 encablures (câbles
de 100 toises ou 120 brasses) - l nœud = vitesse de un mille/heure.
1768 : premier loch à moulinet avec un compte-tours incorporé.
1802 : loch mécanique
1888 : loch électrique à coupelles
La mesure du mille est fixée à 1852 mètres.
Pour les voiliers actuels, on utilise un nœud théorique de 15,43
mètres et pratique de 14,62 mètres, pour corriger l'effet d'entraînement
(Loch Walker).
Porter le point : la carte et le tracé de la route
- Portulans-livres : description de la côte avec des figures
- Portulans-cartes : premiers graphiques des marins
- Carte pisane : c'est la plus vieille carte marine, faite de cartes bâties
par petits morceaux de projections planes rapportées - pas d'échelle
ni longitude ni latitude.
1541 : globe de Mercator (géographe flamand Gerhard Kremer)
1569 : première carte de Mercator (faite à partir du globe)
: c'est la vraie carte du marin.
Coexistent longtemps les portulans-cartes, la carte de Mercator et les "cartes plates" (la première est portugaise de 1485), et les cartes par routes et hauteurs où figurent seulement les latitudes.
 Dès
1640, les cartes sont imprimées (suppression des erreurs des copistes
et plus grande diffusion).
Dès
1640, les cartes sont imprimées (suppression des erreurs des copistes
et plus grande diffusion).
1772 - La formule des latitudes croissantes tient compte de l'aplatissement
de la Terre.
Fin XVIIIème, le relief terrestre est indiqué sur les cartes
marines.
Début XIXème, unification progressive des signes et symboles.
1880 : les régions les plus visitées sont cartographiées.
1920 : encore compléments et rectifications des longitudes.
Les erreurs considérables dues aux fausses longitudes calculées avant la pratique des chronomètres sont souvent cause de naufrages.
Jusqu'au XIXème siècle, l'analphabétisme est la règle chez les pêcheurs, caboteurs et marins du large, donc ils préfèrent les instruments et les graphiques et ne lisent pas.
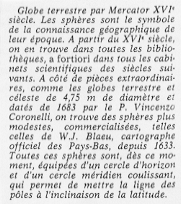 Début
XVIIème, apparition des premiers portulans-livres imprimés hollandais,
très illustrés de représentations de ports, mouillages,
profils de côtes : ceux sont des livres de pilotage.
Début
XVIIème, apparition des premiers portulans-livres imprimés hollandais,
très illustrés de représentations de ports, mouillages,
profils de côtes : ceux sont des livres de pilotage.
Les ouvrages de navigation pure sont davantage destinés aux astronomes.
1252 : tables alphonsines (publiées sous Alphonse le Sage de Castille)
: elles indiquent les déclinaisons du soleil.
1475 : Regiomontanus publie des éphémérides ("regimentos"
portugais)
1679 : "Connaissance des temps" publié en France
1839 : Annuaire des marées. Avant, on avait un calculateur circulaire
de poche. Un manuel hollandais du XVIème est augmenté et repris
en Angleterre en 1588.
1767 : " Nautical Almanach "
LE PILOTAGE PRATIQUE
Des débuts de la navigation hauturière au XVIIIème siècle,
le pilote était le vrai navigateur du navire (Pinzon pour Colomb).
Au XVIIIème siècle, on met en place les premiers brevets d'officier.
Donc, la navigation astronomique et l'estime sont assurées par l'état-major
des bâtiments. Le pilotage n'est plus que la conduite du navire à
proximité de la terre avec des sondes et les repères de la côte
(Maintenant c'est pareil, sauf qu'on utilise des sondeurs à ultrasons,
des jumelles à fort grossissement ou alignements radio-électriques).
Mesure du fond
Jusqu'au XIXème, la sonde à main est utilisée.
Puis, avec l'apparition des lochs mécaniques, on crée également
des appareils de mesure du fonds avec compteur incorporé (nombre de
tours d'ailettes, puis pression de l'eau, puis sondeur piézo-électrique,
à quartz et enfin sonar).
Longues-vues = Lunettes
Utilisées dès leur apparition mais plus pratiques à partir
du XVIIIème siècle.
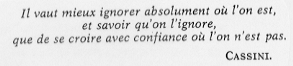 Les
lois des mouvements des astres ont été découvertes par
:
Les
lois des mouvements des astres ont été découvertes par
:
- 1546-1601 : Tycho Brahe
- 1571-1630 : Kepler
- 1642-1727 : Newton
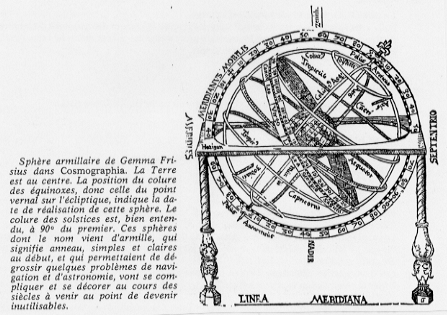 Jusque-là,
les marins utilisaient simplement le soleil et l'étoile polaire.
Jusque-là,
les marins utilisaient simplement le soleil et l'étoile polaire.
L'étoile polaire : utilisée depuis l'Antiquité.
Le soleil : plus difficile à manier à cause de sa déclinaison
saisonnière variable. Il est probable que les latitudes ont été
déterminées par les astronomes dès les premiers siècles
de notre ère, ainsi que l'axe nord-sud du méridien.
Les cosmographes cherchent d'abord la réalisation matérielle
du triangle de position, c'est à dire la construction exacte des données
angulaires (pôle, astre, zénith) sur le globe : mais c'est très
imprécis.
Puis ils font des observations plus fines (hauteurs à la minute d'arc,
heure à la seconde), ce qui est déjà un grand progrès
par rapport à l'époque pas si lointaine de l'alchimie et des
sciences ésotériques : ils privilégient l'observation
directe par rapport aux conceptions préconçues.
En attendant les cartes planes, des globes sont utilisés pour les
besoins nautiques, pour calculer les routes et distances réelles grâce
au compas à pointes sèches.
1492 - Premier globe connu fait par Martin Behaim, de retour du Portugal (exposé
à Nuremberg).
1520 - Mappemonde de Schoener .
1540 - Mercator.
1600 - Globes à fuseaux imprimés et globes vierges, globes célestes,
sphères à armilles ou sphères armillaires qui servaient
à dégrossir les calculs.
Le cosmolabe, inventé par Jacques Besson en 1567, est l'ancêtre
du théodolite et de la navisphère. Il répond au souci
des savants du XVIème siècle, préoccupés d'astronomie
et de mécanique, voulant un appareil qui puisse inscrire le point sur
le globe à partir de l'observation directe des astres (ou au moins
savoir l'heure par l'observation directe). Il est inutilisable par les marins
car la chaise anti-roulis n'a pas été inventée !
Premiers instruments des mesures angulaires
L'idée, c'est de mesurer la hauteur d'un astre (distance angulaire
ou angle entre l'horizon et l'astre) dans le plan méridien (hauteur
de culmination) pour calculer la latitude.
En Europe, on utilisait un bâton tenu à bout de bras pour mesurer
une hauteur ou les arpents d'une pièce de terre. Il était l'ancêtre
du bâton de Jacob ou de Lévi, décrit dans le traité
de trigonométrie de Lévi ben Gerson d'Avignon (1342).
Fin XVème, au début de la navigation astronomique, les marins
se l'approprient :
- ils effectuent d'abord des visées "par-devant" (mais éblouissement)
- puis "par-derrière" (par ombre portée)
Cf. schéma page 87
appelé aussi arbalète, arbalestrille, verge d'or et tire-pied.
1768 : il est encore utilisé, avec des corrections (demi-diamètre
apparent du soleil, élévation de soleil, réfraction quand
le soleil descend au-dessous de 45° par rapport à l'horizon).
L'astrolabe, inventé par les Arabes (p. 83), est un peu plus précis que la flèche (bâton de Jacob) : il permet des mesures à 4 ou 5 degrés près pour les étoiles (avec le roulis) en visée directe et un demi degré pour le soleil par ombre projetée. La flèche mesure un angle à 12 ou 15' près (très bien).
Quartier de Gunter (p. 86) ou quadrant.
Quartier anglais ou de Davis (p. 89)
1595 : C'est le premier instrument de marin : il a succédé à
la flèche à cause de son verre.
Les instruments à réflexion (p. 94-95) et miroirs tournants prennent la suite du quartier, fin XVIIème avec 2 miroirs et XVIIIème : octant.
La pratique du point astronomique
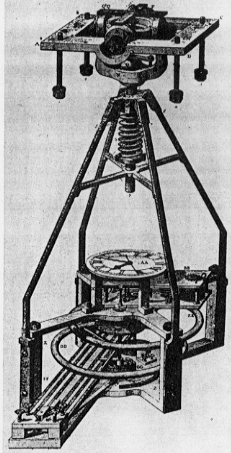 Fin
XVème, les méthodes réellement pratiquées sur
les navires portugais ne sont pas très orthodoxes : ils font des simplifications
parfois pas très logiques, mais donnant de bons résultats.
Fin
XVème, les méthodes réellement pratiquées sur
les navires portugais ne sont pas très orthodoxes : ils font des simplifications
parfois pas très logiques, mais donnant de bons résultats.
Pour la longitude, on avait établi qu'en son principe, un astre parcourant
les 360° du pourtour terrestre dans le mouvement apparent, il suffisait,
au moment où il passait au méridien, de savoir à quelle
heure (heure locale d'observation) il était passé au méridien
d'origine pour déterminer à combien d'heures et minutes et donc
de degrés et minutes d'arc on était de ce point d'origine.
![]()
Mais il y avait un problème : il n'y avait pas de pendule ou de montre à cette époque. On a alors imaginé des repères de temps : les conjonctions luni-solaires, les éclipses de lune, les conjonctions lune - planètes - c'étaient des phénomènes prévus pour une heure précise du méridien d'origine, par conséquent, il n'y avait plus qu'à noter l'heure locale du moment où ils se produisaient et faire la différence du temps pour connaître la longitude. Les éclipses et distances lune - soleil figurent dans les Almanachs dès la fin du XVème (éphémérides de Regiomontanus).
1610- Galilée découvre les 4 premiers satellites de Jupiter et constate leur éclipse.
1664 - Cassini dresse une table.
Faute de bons instruments pour observer les phénomènes et de
calculs précis des heures, on obtient des résultats probants
seulement au XVIIIème siècle. Donc, on continue à chercher
un bon garde-temps (chronomètre).
Restait la lune, avec la méthode des distances lunaires, qui ne nécessite
pas de chronomètre.
1837 - Méthode de Marc St Hilaire ????????? qui utilise le sextant et le chronomètre. C'est maintenant une méthode universelle (dès qu'on sort des zones de navigation radio-électrique).
La lune est une montre à repères : passage au méridien, hauteur, occultation des étoiles, "apulses" (la lune et une étoile dans le champ d'une même lunette), conjonctions étoile - lune, distances lune - soleil.
Pour la mer, seule la méthode des distances est retenue.
Ex : Soit une étoile sur l'orbite de la lune. La lune s'approche ou
s'éloigne d'elle de la valeur de son mouvement en longitude.
1°) on connaît la distance de la lune à une étoile
zodiacale
2°) on calcule pour le même instant la distance étoile -
lune pour le méridien du lieu de l'observation.
Si les distances sont égales, on est sur le même méridien,
sinon on calcule la différence à la longitude du calcul pour
trouver son propre méridien d'observation.
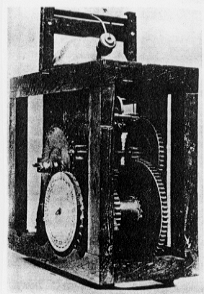 Cette
méthode est recommandée en 1514 . . . 1600 (par Kepler)
Cette
méthode est recommandée en 1514 . . . 1600 (par Kepler)
1665 : Construction de l'observatoire de Greenwich pour travailler aux mouvements
des astres pour aider les marins à calculer la longitude.
![]() XVIIIème siècle
: on poursuit la correction des longitudes (1714, le Parlement d'Angleterre
crée un comité - 1767, un astronome royal répand la méthode
lunaire)
XVIIIème siècle
: on poursuit la correction des longitudes (1714, le Parlement d'Angleterre
crée un comité - 1767, un astronome royal répand la méthode
lunaire)
Publication des premiers éphémérides nautiques destinés
aux marins.
Les calculs se compliquent, donc on invente des graphiques (abaques de résolution.
..)
Les instruments de mesure d'angle se perfectionnent : octant, sextant, quintant,
cercle à réflexion (1752).
Les distances lunaires sont utilisées jusqu'à l'équipement
des navires en chronomètres (1850-60)
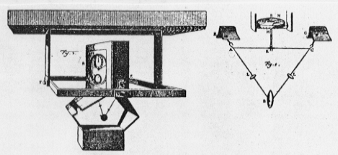 C'est
un élément du point astronomique. C'est un élément
de l'estime pour le calcul de la vitesse, un élément de la vie
quotidienne à bord. Une des grandes préoccupations des marins
est la manière de la connaître et la manière de la conserver.
C'est
un élément du point astronomique. C'est un élément
de l'estime pour le calcul de la vitesse, un élément de la vie
quotidienne à bord. Une des grandes préoccupations des marins
est la manière de la connaître et la manière de la conserver.
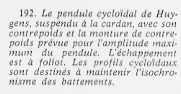 Le
temps vrai : c'est le jour solaire
(intervalle de temps qui s'écoule entre deux passages successifs du
centre du soleil au méridien d'un même lieu) (midi vrai).
Le
temps vrai : c'est le jour solaire
(intervalle de temps qui s'écoule entre deux passages successifs du
centre du soleil au méridien d'un même lieu) (midi vrai).
Il est un peu plus long que le temps sidéral
(de 4 mn) car tout en tournant sur elle-même, la Terre tourne
autour du soleil. En plus, le jour solaire n'est pas constant (l'orbite de
la terre est une ellipse : elle décélère vers l'apogée
et accélère vers le périgée - la proximité
du soleil accélère sa rotation). En outre, Faxe de rotation
est penché ("obliquité de l'écliptique sur l'équateur"),
donc le jour solaire le plus long est le 23 décembre (supérieur
de 30 secondes au temps moyen) et le jour solaire le plus court est le 16
septembre (supérieur de 21 secondes au jour sidéral).
Le temps sidéral : c'est l'intervalle de temps entre deux passages successifs d'une même étoile au méridien du lieu. Il est constant et inférieur au jour solaire.
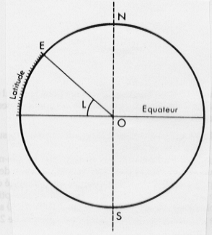 Le
temps moyen : il est calculé avec un soleil fictif parcourant
l'écliptique et passant à l'apogée et au périgée
en même temps que le soleil vrai.
Le
temps moyen : il est calculé avec un soleil fictif parcourant
l'écliptique et passant à l'apogée et au périgée
en même temps que le soleil vrai.
L'équation du temps : c'est la formule qui permet de passer du temps
moyen au temps vrai.
Jour et mois lunaires
C'est intéressant de les connaître à cause des marées.
Le jour lunaire, c'est le temps écoulé entre deux passages successifs
de la lune au même méridien : 24 h 50,5 mn de temps moyen.
La révolution synodique : 29 jours 12 h 44 mn 2,9 s du temps moyen
(La lune passe une fois de moins que le soleil au méridien).
Donc l'heure lunaire est égale à l h 2,6 mn 2 s.
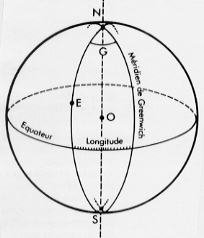 Division
du temps de la journée
Division
du temps de la journée
XIVème siècle : le sablier pour les durées courtes, le
cadran solaire universel, suspendu par un anneau.
XVème siècle : montres de poche (médiocres). 1760 : chronomètres
En fait, les marins vivaient à l'estime du soleil (comme les paysans)
et utilisaient les sabliers pour les quarts (sans doute).
Jusqu'au XXème siècle, les navires vivent à l'heure solaire
(midi vrai) : on change d'heure tous les jours.
Au XVIIIème siècle, on effectue des calculs avec l'heure du
chronomètre réglé en temps du méridien d'origine
(Greenwich ou Paris).
Pour faciliter les liaisons radio, on opte pour l'heure des fuseaux (on avance
ou on retarde d'une heure pendant la nuit).
Le tour de la Terre fait 360°, soit 24 fois 15°. Les compagnons de
Magellan de retour du tour du monde sur la Victoria sont arrivés avec
un jour de moins que le jour compté à terre (s'ils avaient tourné
en sens inverse, vers l'est, ils seraient arrivés avec un jour de plus).
C'est une "erreur normale" : au méridien 180, il faut redoubler
la date vers l'ouest et soustraire un jour vers l'est.
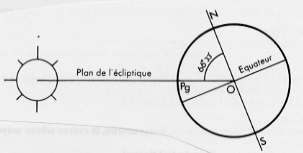 Le
sablier : ce sont deux fioles coniques séparées par
une plaque à trous calibrés et assemblées par du fil.
Le sable très fin est fait de coquilles d'œuf finement pilées
(Antiquité : poudre de marbre noir "séchée neuf
fois").
Le
sablier : ce sont deux fioles coniques séparées par
une plaque à trous calibrés et assemblées par du fil.
Le sable très fin est fait de coquilles d'œuf finement pilées
(Antiquité : poudre de marbre noir "séchée neuf
fois").
A bord, les sabliers d'une demi-heure appelés horloges sont retournés
à partir du top de midi jusqu'au lendemain (précision très
relative : dépend de Inexactitude des marins).
- Cf. anecdote p. 141 Duguay Trouin
Les sabliers ont été employés jusqu'au XIXème
siècle.
Le cadran solaire : Cadran universel (sphère universelle à arrnilles) - " Universal ring " de Wright : véritable montre de marin fabriquée jusqu'au XIXème siècle " Cf. p. 160-
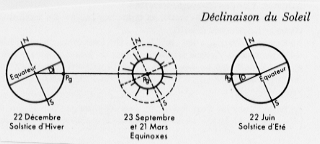 Le
nocturlabe : d'abord utilisé par les astrologues pour savoir
l'heure la nuit, puis utilisé sur les navires au XVIème et XVIIème
siècle.
Le
nocturlabe : d'abord utilisé par les astrologues pour savoir
l'heure la nuit, puis utilisé sur les navires au XVIème et XVIIème
siècle.
Le plus simple repère est Malignement d'étoiles du Grand Chariot
(Grande Ourse), de la Petite Ourse et de l'Etoile polaire, qui fait un tour
complet du ciel en 24 heures. Sachant la position angulaire de l'axe des 3
étoiles à minuit, on calcule l'heure approximative.
Horlogerie de marine
Des récompenses sont offertes aux inventeurs d'une bonne méthode
de calcul de la longitude:
1598 :2000 écus proposés par Philippe III, roi d'Espagne
1600: 100 000 livres proposées en France
1714 :20 000 livres sterling sont proposées par le Parlement anglais.
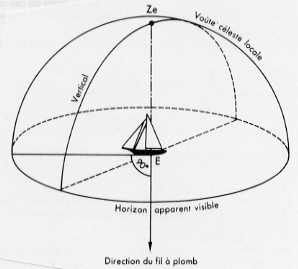 1500
: Première montre à ressort : "Oeuf de Nuremberg",
de Peter Hele ou Heulein
1500
: Première montre à ressort : "Oeuf de Nuremberg",
de Peter Hele ou Heulein
1700 : Toujours pas de progrès : variation journalière considérable,
irrégulière et incontrôlable.
1669 : Huygens essaie en mer une horloge marine à pendule cycloïdal
(elle donne une plus grande erreur -150 km en longitude - que la méthode
des distances lunaires).
Plusieurs mécanismes sont inventés par John Harrison (né
en 1693) : en 1735, 1739, 1756, 1759 (il sera primé à l'âge
de 80 ans) - Essai concluant en 1761.
Sa quatrième invention a été utilisée avec succès
par James Cook : invention géniale et excellents résultats.
Mais les principes n'étaient pas généralisables, donc
il faut attendre :
- Pierre Le Roy (1717-1785)
- Ferdinand Berthoud (1725-1807)
pour qu'ils mettent au point séparément le chronomètre
moderne avec les principes fondamentaux :
1°) Isochronisme du spiral (balancement régulier)
2°) Echappement libre (le rouage et le balancier sont indépendants)
3°) Compensation en température sur le balancier.
XIXème : industrialisation des montres
XXème : chronomètres à quartz, et montres mises à
l'heure par un top horaire à partir de la radio.
Il est intéressant de prendre conscience des conditions de vie dans la région dans le passé, notamment à la fin du Moyen Age, au moment où l'Europe toute entière change de mentalité et s'ouvre à la connaissance du globe terrestre, des sciences et des techniques. C'est à partir de la fin du XIVème siècle, à l'époque où l'Angleterre possédait encore une bonne partie de la France, que s'amorce le changement.
A l'époque, chaque région avait sa propre organisation administrative, fondée sur la coutume. Pour les Basques, leur vie très communautaire, centrée autour de la maison (etxe), était basée sur le droit d'aînesse. Cela signifie que les autres enfants devaient impérativement trouver du travail ailleurs, si l'exploitation familiale n'y suffisait pas. Une partie des hommes se tournait donc vers la marine, à bord des bateaux de pêche ou de ceux du roi (marine de guerre, de commerce, d'exploration ou corsaires). En ce qui concerne les habitants des Landes, l'intérieur était tellement peu cultivable que la majorité des hommes devenait marin ou pêcheur.
Le Golfe de Gascogne leur a suffi longtemps, mais
à partir du XIVème, les baleines se raréfient et les
pêcheurs passent progressivement de la pêche côtière
à la pêche hauturière, pour aller les chercher jusqu'à
Terre-Neuve, au large du Canada, où ils découvrent des bans
de morues d'une densité extraordinaire.
Parallèlement, les gouvernements s'intéressent de plus en plus
à l'exploration de la Terre et à la recherche de nouvelles richesses
(Amériques, Afrique) et les penseurs et scientifiques de l'époque
se posent le problème de l'orientation au milieu des mers, loin de
toute côte.
L'analphabétisme a été de règle jusqu'au XIXème siècle : les progrès étaient donc lents à se diffuser et les méthodes d'orientation compliquées peu généralisables. Les pilotes de navire avaient des instruments d'abord très simples et utilisaient principalement le soleil, la lune et l'étoile polaire pour se diriger (par temps de brouillard et de nuages, il ne leur restait que la boussole, ou compas, pour ne pas être totalement perdus). Ils préféraient les représentations en trois dimensions (globes terrestres et célestes, sphères armillaires) et les dessins (profils de côtes, cartes maritimes), ainsi que les calculs simples (ou simplifiés par des tables ou abaques).
Une collaboration s'est établie entre les marins, les savants et les gouvernements, afin d'améliorer progressivement jusqu'à nos jours les conditions d'orientation sur les mers.
- Le compas indiquait le nord, mais pendant longtemps
avec des erreurs non corrigées (nord magnétique au lieu de géographique,
influence des masses ferreuses du navire, frottements empêchant l'aiguille
de bien se positionner, mouvements du bateau).
- Le loch donnait une estimation très approximative de la vitesse du
navire, et donc de la distance parcourue depuis le départ ; en outre,
le chronomètre n'a été mis au point qu'au XVIIIème
(pour mesurer le temps écoulé depuis le départ), et les
dimensions exactes de la Terre (rayon, donc mesure du mille marin, équivalent
à une minute d'arc à l'équateur) ont longtemps été
sous-estimées.
- Le positionnement du navire sur une carte (détermination de la latitude
et de la longitude) a nécessité la compréhension plus
approfondie des mouvements des astres et l'invention d'instruments toujours
plus perfectionnés de mesure de leurs distances angulaires.
Notre vie actuelle est donc totalement issue de
ces époques de découvertes, où le simple fait d'embarquer
sur un bateau de pêche était déjà toute une aventure
et faisait la preuve d'un courage très remarquable.
|
|
|
|
|
|
|
|
|