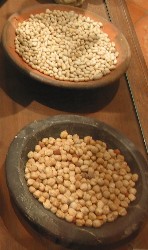
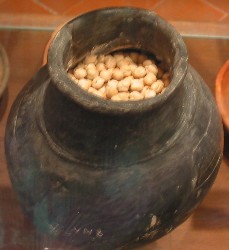 Thuir
ne nous inspire pas, il y a des travaux qui bloquent l'accès au centre
ville et les rues ne nous semblent pas pittoresques (le Sud-Est n'a
rien à voir avec le Pays Basque, la Bretagne ou l'Alsace, les
gens ont moins le souci de soigner leur maison et leurs rues en règle
générale),
par contre nous faisons halte à Elne où nos prospectus
vantent le cloître
roman
que nous
nous décidons à visiter. Pas de guide là non plus,
mais un musée intéressant
au sous-sol qui complète utilement les chapiteaux et le jardin
du rez-de-chaussée.
On y explique le rôle de la céramique, bien plus utilisée
qu'à l'heure
actuelle : "Elle a deux rôles, celui de contenant de réserves
(récipients
de grande taille, cruches, pots ovoïdes, jarres à fond plat,
amphores...) et celui de vaisselle pour la préparation des repas
- céramique à pâte
non poreuse - (pots, écuelles, jattes, marmites, cruches, mortiers...)."
Moins pratiques que nos emballages de plastique, papier, carton ou aluminium,
notamment par leur poids et leur absence de couvercle, ils sont nettement
plus esthétiques à mon goût et donnent l'envie irrépressible
de les caresser tant leurs formes sont douces, généreuses
et arrondies.
Thuir
ne nous inspire pas, il y a des travaux qui bloquent l'accès au centre
ville et les rues ne nous semblent pas pittoresques (le Sud-Est n'a
rien à voir avec le Pays Basque, la Bretagne ou l'Alsace, les
gens ont moins le souci de soigner leur maison et leurs rues en règle
générale),
par contre nous faisons halte à Elne où nos prospectus
vantent le cloître
roman
que nous
nous décidons à visiter. Pas de guide là non plus,
mais un musée intéressant
au sous-sol qui complète utilement les chapiteaux et le jardin
du rez-de-chaussée.
On y explique le rôle de la céramique, bien plus utilisée
qu'à l'heure
actuelle : "Elle a deux rôles, celui de contenant de réserves
(récipients
de grande taille, cruches, pots ovoïdes, jarres à fond plat,
amphores...) et celui de vaisselle pour la préparation des repas
- céramique à pâte
non poreuse - (pots, écuelles, jattes, marmites, cruches, mortiers...)."
Moins pratiques que nos emballages de plastique, papier, carton ou aluminium,
notamment par leur poids et leur absence de couvercle, ils sont nettement
plus esthétiques à mon goût et donnent l'envie irrépressible
de les caresser tant leurs formes sont douces, généreuses
et arrondies.
Une
collection de meules plus ou moins perfectionnées montrent ce besoin
des humains d'améliorer sans cesse
les procédés, ils ne se contentaient
pas de mâcher les graines, et le pilon n'a pas suffi non plus, il a
"fallu" qu'ils inventent les meules, et le Moyen-Age représente l'époque
par
excellence des débuts de l'industrialisation, avec le développement
des moulins à eau et à vent. Le
musée distingue "les meules à friction, utilisées dès le néolithique,
où l'on écrasait le grain sur une grande pierre à l'aide d'une pierre
plus petite, indépendante,
des
meules à roue, mues manuellement à l'aide d'un manche de bois, puis à
la force de l'animal ou de l'eau, difficilement
datables parce que réemployées, utilisées, réparées, améliorées au cours
des siècles, qui apparaissent avant le 1er siècle avant J.-C. et sont
utilisées jusqu'à l'époque moderne".
Des panneaux retracent l'histoire de
la région et expliquent notamment l'influence romaine sur la structure
foncière qui a perduré après la chute de l'empire. "On assiste à un développement
de l'occupation des campagnes environnantes, avec la création de nombreuses
villae. On connaît, de part et d'autre du cours du Tech, plusieurs de
ces gros domaines agricoles. Ils sont, contrairement aux maisons d'Elena
(le nom romain de la ville d'Elne), richement décorés de mosaïques multicolores,
de marbres de différentes couleurs, d'éléments sculptés, d'enduits peints...
Ces domaines témoignent bien de la richesse des propriétaires qui exploitaient
le territoire illibérien. Cette importance va perdurer bien au-delà de
la domination romaine."
D'autre
part, à l'étage
au-dessus, un panneau indique une liste de plantes qui étaient
cultivées
dans le jardin médiéval et un autre montre que la connaissance
des plantes médicinales
fait partie du savoir de base de toutes les civilisations. Voici pour
mémoire son contenu. Théophraste,
philosophe et naturaliste grec (372-288 av. J.-C.), décrit de
nombreuses plantes grecques et étrangères dans son ouvrage
intitulé Histoire des plantes,
il mentionne leurs divers usages et établit la 1ère classification
des plantes. Pline l'Ancien (23-79), naturaliste et écrivain latin,
s'est aussi intéressé à la botanique et aux vertus
thérapeutiques des plantes.
Il cristallisera une idée qui devait déjà être
en germe chez les Grecs et sera énoncée par Paracelse de
la théorie des Signatures (Paracelse
répartissait les plantes médicinales selon 7 groupes en
rapport avec les 7 planètes et les 7 couleurs de l'arc-en-ciel).
Dioscoride (40-90), médecin grec, fut considéré comme
le père spirituel de la pharmacognosie
(étude des médicaments d'origine animale ou végétale).
Il inventorie 520 espèces de plantes dans la matière médicale,
traité qui fit autorité
en Europe jusqu'au Moyen Age. Charlemagne (742-814) en reprit les termes
dans ses Capitulaires qui recommandaient la culture de 88 plantes médicinales
et tenta d'élever le niveau intellectuel du clergé en créant
des écoles
religieuses
où l'étude
des plantes curatives était la base de l'enseignement
médicinal. Walafrid Strabon (623-649), abbé de Reichenau
(Abbaye du St Graal en Suisse), rédige en 820 un parchemin qui
donne les premières
traces précises du jardin monastique où il décrit
les 23 plantes qui le composaient et leurs propriétés.
Saint Bernard (1090-1153), fondateur de l'Abbaye de Clairvaux en 1115,
accorde une place importante à la culture
du jardin monastique dans la Règle Monastique qu'il rédige.
"Simple" est un mot qui apparaît au XVe siècle. Il désigne alors un médicament constitué d'une seule substance, par opposition aux mélanges alambiqués (au sens propre) de la médecine savante. Il finira par s'appliquer uniquement aux plantes médicinales. Le jardin est omniprésent dans les monastères. Conformément au modèle du plan de l'abbaye de Saint Graal, ce n'est pas un jardin mais trois jardins souvent entourés de murs ou de haies qui composent le jardin monastique. Le premier est le jardin des Simples ou Herbularius, situé souvent près de l'infirmerie ou du laboratoire des moines apothicaires. On n'y cultive pas uniquement des simples, mais aussi des plantes aromatiques et condimentaires qui, pour la plupart, ont aussi une faculté curative. Le second, généralement proche du premier, est le potager ou Hortus, où l'on cultive des légumes et des racines qui permettent de subvenir aux besoins du monastère et servent également, ainsi que les fruits, très souvent également de médicaments. Distinct du jardin des Simples dans les grandes abbayes comme à Vauclair ou Clairvaux, mais confondu avec lui ailleurs, il y a aussi le jardin des fleurs, cultivées pour leur rôle décoratif dans les cérémonies religieuses, mais qui ont également une action médicamenteuse.
Après la visite, nous restons
un moment
à l'accueil à regarder la collection de livres qui est
en vente et nous voyons tout d'un coup entrer un énergumène
très excité, muni d'une pile
de prospectus, qui s'adresse au jeune guichetier du cloître en
clamant qu'il faut impérativement faire la visite du musée
de la mine d'Escaro, que
le couple qui l'a créé a réalisé un travail
extraordinaire en récupérant
tous les bouts de ferraille encore sur place pour reconstituer une locomotive
fonctionnelle sur ses rails, 30 modèles de wagonnets, les outils
des mineurs et les objets de leur vie quotidienne, ainsi qu'en réunissant
une foule de documents.
Le mari,
fils de mineur, a effectué un véritable travail de mémoire,
cela vaut le coup de l'interroger, il est passionnant, etc., etc. !
Et
tout d'un coup, il prend conscience de notre présence et nous
fait une proposition
étonnante : "Et si vous voulez, cet après-midi, vous
pouvez assister
à mon atelier de préhistoire !" Sur ce, il s'en va,
je règle le livre
"La femme au Moyen-Age" et le guichetier confirme : "Je
vous assure, il est très intéressant, vous devriez y aller".
Il est une heure et demie passée, nous avons surtout faim, il
nous indique deux restaurants proches et, à tout hasard, l'emplacement
de l'atelier. Bien que ce dernier commence
à 2h30 et que nous ayons fini de manger à 45, nous tentons
le coup, sans savoir à quoi nous attendre, par curiosité.
Après quelques errements dans
les rues vides et brûlantes, nous découvrons une placette
retirée et deux salles
de classe réunies d'un seul tenant en haut d'un escalier de pierre.
Notre homme nous y attend, en compagnie d'un jeune garçon de CM2
d'Elne, venu en voisin, lui aussi passionné de préhistoire.
André Mazière anime l'association
La Société des
Amis d'Illibéris de façon fort originale, puisqu'il
essaie de retrouver les gestes oubliés des hommes préhistoriques.
Comme eux, il taille le silex, réalisant des outils de pierre
taillée, choppers, bifaces,
lames très fines de couteau et des outils de pierre polie (très
longs
à réaliser,
avoue-t-il). Il en a une belle collection par terre, rangée chronologiquement
sur une longue bande de tissu ou papier avec des photos et indications.
Quelques uns sont des originaux, trouvés sur des talus creusés par les
rivières, d'autres sont de sa fabrication, mais on s'y méprendrait. Après
une petite présentation à l'aide de transparents, tout en nous les faisant
passer, de façon à ce que nous ayons une idée très concrète de leur facture,
il passe à la démonstration pratique. Il enfile une mitaine de cuir,
pose sur sa cuisse une fourrure repliée plusieurs fois pour se protéger,
s'empare d'un gros morceau de silex, récolté dans un gisement du Nord
de la France (parce qu'ils y sont de meilleure qualité), et se met à
cogner dessus, de façon très technique, en biais, pour en dégager des
éclats et obtenir l'outil désiré.
Ce qui est intéressant, c'est de voir
les difficultés qu'il rencontre dans sa tâche. Le silex est une roche
sédimentaire siliceuse très dure, constituée de
calcédoine presque pure, et d'impuretés telles que de l'eau
ou des oxydes, ces derniers influant sur sa couleur. Très abondant,
le silex forme des accidents siliceux dans la craie ou dans le calcaire
sous forme de nodules, et certains sols argileux, généralement
issus d'altérations de la craie. C'est le cas notamment en Haute-Normandie,
en Champagne ou dans le Pas-de-Calais (diluvium d'Helfaut) (informations
issues de Wikipédia). En réalité, à voir faire notre démonstrateur, le
silex ne semble pas si solide que cela. Il se comporte un peu comme un
cristal, c'est à dire que les éclats se détachent suivant les ondes de
choc, dont il nous fait remarquer les ondulations caractéristiques sur
les fragments qui se détachent, notamment peu après le lieu d'impact,
où l'on voit des stries en étoile, un renflement suivi parfois de deux
ou trois fins bourrelets en arcs de cercle
concentriques : c'est assez étonnant à voir. D'ailleurs, ce phénomène
d'onde de choc permet d'user de "marteaux" différents selon le résultat
désiré, un gros caillou, un andouiller de rêne à deux branches sciées
en biais, un os ou un morceau de bois (dans Wikipédia : faculté de
se fractionner selon des lois constantes et contrôlables, en formant
des arêtes tranchantes (cassure conchoïdale, qui a l'aspect
d'une coquille, cassure franche courbe et lisse que l'on retrouve souvent
chez les roches à grain très fin telles que le silex, l'obsidienne
ou le calcaire lithographique).
Il mascagne un peu, car les nodules de
silex en question contiennent parfois des impuretés, des incrustations
de calcaire ou autre, qui empêchent l'onde de choc de se propager régulièrement
et donnent des éclats incomplets, fragments inutilisables pour fabriquer
les magnifiques bifaces dont il nous fait admirer la symétrie, la beauté
des lignes, qui, tout autant qu'utilitaires, témoignaient - d'après André
Mazière - d'un souci d'esthétique qui nous touche encore et dans lequel
nous n'avons aucun mal à reconnaître le trait commun d'humanité qui nous
unit à travers les millénaires.  A ce propos, je me rappelle les propos
d'un conférencier passionnant (Dr Bruno CAHUZAC, Maître
de Conférences
- Université Bordeaux-1, UFR Sciences de la Terre et de la Mer)
dans sa "Présentation géologique de la Chalosse
et histoire du Bassin aquitain" au Foyer
rural de Brassempouy le 5 juillet dernier, qui évoquait la
difficulté
d'interprétation
des reliefs de taille de silex. Comme les gisements sont circonscrits
dans des sites connus et reconnaissables à leur teinte et leur composition,
on peut facilement savoir l'origine des silex trouvés dans un site, où
qu'il se situe. Le problème, c'est de déterminer si les humains qui les
ont taillés sont allés les chercher eux-mêmes à des centaines de kilomètres,
ou bien s'il s'est constitué une sorte de commerce ou de troc, de proche
en proche, jusqu'à ce groupe d'humains qui n'aurait circulé que dans
un rayon de peu de kilomètres. Evidemment, personne n'a la réponse.
A ce propos, je me rappelle les propos
d'un conférencier passionnant (Dr Bruno CAHUZAC, Maître
de Conférences
- Université Bordeaux-1, UFR Sciences de la Terre et de la Mer)
dans sa "Présentation géologique de la Chalosse
et histoire du Bassin aquitain" au Foyer
rural de Brassempouy le 5 juillet dernier, qui évoquait la
difficulté
d'interprétation
des reliefs de taille de silex. Comme les gisements sont circonscrits
dans des sites connus et reconnaissables à leur teinte et leur composition,
on peut facilement savoir l'origine des silex trouvés dans un site, où
qu'il se situe. Le problème, c'est de déterminer si les humains qui les
ont taillés sont allés les chercher eux-mêmes à des centaines de kilomètres,
ou bien s'il s'est constitué une sorte de commerce ou de troc, de proche
en proche, jusqu'à ce groupe d'humains qui n'aurait circulé que dans
un rayon de peu de kilomètres. Evidemment, personne n'a la réponse.
 André Mazière nous montre qu'il n'est
point besoin de cogner très fort pour travailler le silex. Une fois dégagée
une lame de bonne dimension, il agit sur ses bords par pressions successives,
à l'aide de l'andouiller ou de toute autre matière douce (bois ou os),
et le travail est bien plus délicat et fin. Il nous fait apprécier le
tranchant ainsi obtenu et nous nous étonnons du poids des plus anciens
outils : évidemment, pour fracasser un os pour en récupérer
la moelle, il était plus fonctionnel d'avoir une masse plutôt que de devoir taper
très fort. Il nous montre les reproductions d'oeuvres d'art qu'il a confectionnées
de ses mains : la dame de Brassempouy, une autre silhouette féminine,
un bas-relief, une peinture d'un animal (du style de celles que l'on
voit dans les grottes de Lascaux ou d'Altamira). Non seulement il est
habile, mais il recèle des dons véritablement artistiques. Il en faisait
faire aux élèves de collège en leur préparant des calques, afin d'obtenir
pour résultat autre chose que des "patates" !
André Mazière nous montre qu'il n'est
point besoin de cogner très fort pour travailler le silex. Une fois dégagée
une lame de bonne dimension, il agit sur ses bords par pressions successives,
à l'aide de l'andouiller ou de toute autre matière douce (bois ou os),
et le travail est bien plus délicat et fin. Il nous fait apprécier le
tranchant ainsi obtenu et nous nous étonnons du poids des plus anciens
outils : évidemment, pour fracasser un os pour en récupérer
la moelle, il était plus fonctionnel d'avoir une masse plutôt que de devoir taper
très fort. Il nous montre les reproductions d'oeuvres d'art qu'il a confectionnées
de ses mains : la dame de Brassempouy, une autre silhouette féminine,
un bas-relief, une peinture d'un animal (du style de celles que l'on
voit dans les grottes de Lascaux ou d'Altamira). Non seulement il est
habile, mais il recèle des dons véritablement artistiques. Il en faisait
faire aux élèves de collège en leur préparant des calques, afin d'obtenir
pour résultat autre chose que des "patates" !
Photos : Plantes dans des bacs à l'abbaye de Fontfroide - Chapiteaux du cloître d'Elne - Détail de vitraux de l'abbaye de Fontfroide (collage de portions de vitraux anciens brisés récupérés et insérés dans des vitraux modernes)